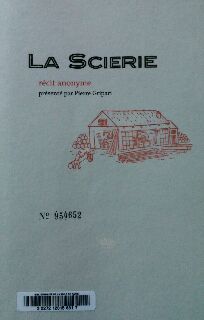
Ces quelques lignes extraites de la conclusion de La scierie m'ont immédiatement rappelé la glorification cynique du travail par la sarkozie et le patronat (pléonasme), répétée en boucle par des privilégiés. A fortiori, je pense aussi que le gouvernement de drauche n'en est pas moins cynique avec sa politique de l'offre et son pendant sur le coût du travail.
« Tout est hostile : la ferraille du ruban, les planches et la sciure gelée – et le bois, toujours là, pas plutôt disparu qu’il est remplacé, le bois inerte, qui ne souffre pas, lui, et qui est le roi du chantier.Je ne peux pas exprimer le dégoût que je ressentais, le matin, quand mon réveil sonnait à cinq heures et demie et que s’offrait à moi la perspective de vingt-cinq kilomètres dans le mauvais vent du nord, et une journée de bagnard. »
Bienvenue dans le monde des forçats du bois. En quelques cent-quarante pages, l'auteur anonyme raconte sans fioriture ses deux ans de vie quotidienne, entre son échec au bac et son départ pour le service militaire au début des années cinquante.
« Deux groupes : les hommes à l’heure, talonnés par les hommes aux pièces. Tout le monde a conscience d’agir dans ses droits les plus élémentaires : les types aux pièces veulent gagner leur vie et sont jaloux des types à qui chaque heure amène soixante-dix francs de plus, automatiquement. Les types à l’heure détestent les gars qui sont aux pièces, qui les font marner et s’énerver sur des machines dangereuses. »
L'auteur, issu d'une famille autrefois aisée, doit travailler. Sans qualification, il trouve son premier job à quelques kilomètres de chez lui. Tout le monde le connait, plus ou moins, et ne donne pas cher de sa peau tant les conditions de travail et l'ambiance sont exécrables. Le patron est rapiat et machiavélique, organisant le travail pour diviser le personnel, les machines sont vieilles, mal entretenues et dépourvues de sécurité, le hangar est ouvert aux quatre vents, le chauffage inefficace, mais malgré tout, il s'accroche à force de courage et d'entêtement jusqu'à devenir un des meilleurs éléments de la scierie.
« Certains soirs, je suis tellement fatigué que je me demande si je vais pouvoir enfourcher mon vélo ! Et le soir n’est rien ; le matin, c’est le matin : celui qui a travaillé me comprendra. Il faut avoir senti cette lassitude au lever, telle qu’on se demande si on va pouvoir sortir du lit, les jointures raides, fatigué à tomber, les jambes molles, le corps entier douloureux dans chaque muscle, toute la viande qui crie grâce !»
L'hiver, le froid les transit, et l'été, la chaleur étouffante fait baisser la vigilance, si bien que les accidents du travail sont plus nombreux. Quand le bois vient à manquer, le narrateur apprend le travail de bucheron. Là encore, le danger et la souffrance sont omniprésents et le travail dantesque.
« Le lendemain matin, je ne peux plus ouvrir les mains. Elles ont gardé la crispation qu’elles avaient la veille sur le manche de cognée : les jointures sont rouillées, soudées, et quand je me force à les ouvrir, en grimaçant, je perçois une espèce de crissement, une espèce de palpitation dans mes paumes, comme si les chairs se déchiraient en se distendant. C’est comme si la viande qui est sur mes mains avait rétréci pendant la nuit. Je m’étonne chaque fois de ne pas voir sortir les os au bout de mes doigts. »
Après la fermeture de la scierie, il retrouve du travail à plus de vingt bornes de chez lui. Deux forces de la nature règnent et imposent un rythme effréné. Après quelques semaine, ces derniers lui proposent de participer à la création de leur propre scierie en Sologne. En échange d'un bon salaire, il va atteindre ses limites physiques, travaillant jour et nuit, dans le froid et sous la pluie jusqu'à ce que la scierie soit construite et produise suffisamment pour sa viabilité. Dans ce dernier épisode, les pages sont émouvantes tant l'incertitude et les difficultés du travail mettent à l'épreuve le physique et le mental de l'auteur et de ses camarades.
« Il faut toujours garder une marge assez importante entre ce qu’on fait et ce qu’on est capable de faire. C’est le seul moyen de ne pas crever, dans ce boulot-là. »
Je ne puis que vous encourager à lire ce récit, très bien écrit comme le fait remarquer l'auteur de la préface, qui narre le quotidien d'un ouvrier sans l'enjoliver, ni tomber dans l'ouvriérisme et le misérabilisme. Si vous aimez Georges Navel, vous ne serez pas déçu-e-s.
Commentaires
_ Nous sommes tous des travailleurs, dit l'attaché de la Caisse des dépôts et consignations à sa secrétaire.
_ Oui, monsieur, nous avons déjà atteint nos objectifs et nous ne sommes qu'en février.
_ Rien de neuf aujourd'hui ?
_ Non, monsieur, c'est très calme.
_ C'est cela, c'est cela, ah ! qu'il fait bon regarder passer les péniches !
La CNP est une filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
On peut avoir quelque souci avec la CNP...
Quant aux péniches, j'ai un témoignage direct (il vaut mieux être au dernier étage ; les trois premiers jours, l'attaché - un ami, philosophe > Maine de Biran - attendait son bureau ; ensuite, il a attendu son premier dossier ; un an plus tard, il était à l'EducNat, puis dans un Rectorat de Basse-Normandie, il pouvait commencer à travailler ; il est définitivement parti il y a trois ans, hélas).
Ce récit paraît très curieux, je l'ai noté pour mes lectures à venir. Est-ce bien un "témoignage anonyme" ? "Récit" peut vouloir dire bien des choses - sans altérer l'authenticité de ce qui est donné à connaître.
J'aime beaucoup ta présentation (depuis déjà quelque temps) avec l'alternance de citations et de phrases de liaison.
Si c'est du niveau de Navel, je ne puis que lire dès que j'en aurais le temps, léger détail qui me manque en ce moment.
Lou, belle histoire. Je lis récit anonyme par un auteur anonyme ;-)
Hubert, je crois que ce livre te marquera. Je l'ai lu en une seule traite.